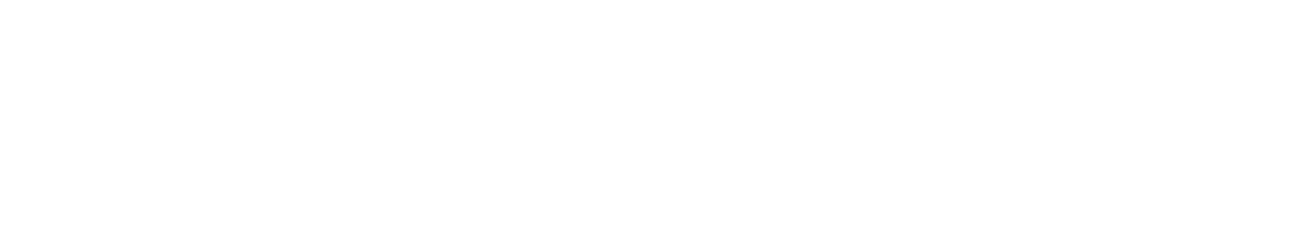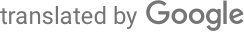Comment le pouvoir de l'identité partagée peut contribuer à désamorcer la désinformation en matière de santé
Summary
- Dans une interview accordée à IHI, Dannagal Young aborde les causes de la désinformation, la manière dont les médias et l'identité façonnent nos croyances et comment les professionnels de santé peuvent améliorer la communication avec les patients. Ell
Dannagal G. Young, titulaire d'un doctorat, est professeure de communication et de sciences politiques à l'Université du Delaware et directrice du Centre de communication politique de l'université. Elle étudie le contenu, le public et les effets de l'information politique non traditionnelle, ainsi que la manière dont les individus perçoivent leur univers politique. Elle a publié plus de 70 articles universitaires et chapitres de livres sur le contenu, la psychologie et les effets de l'information politique, de la satire et de la désinformation. Son dernier ouvrage, Wrong: How Media, Politics, and Identity Drive our Appetite for Misinformation , explore la demande en matière de désinformation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles nous sommes attirés par les mensonges.

Une grande partie de vos travaux porte sur la façon dont nous traitons l'information et la désinformation. Comment la désinformation s'infiltre-t-elle dans notre politique et notre santé ?
De nombreuses recherches portent sur le contenu de la mésinformation et de la désinformation, ainsi que sur leur diffusion. Mais, compte tenu du fonctionnement de notre environnement médiatique, la diffusion de fausses informations serait moins importante s'il n'y avait pas de demande. J'ai donc cherché à comprendre les besoins que la désinformation satisfait : ce qu'elle « perçoit » et pourquoi elle les intéresse.
Je souhaitais également écrire sur le sujet en reconnaissant que nous avons tous ces besoins. J'ai donc décidé de l'aborder avec humilité et de dire : « Même en tant que spécialiste des sciences sociales, je suis vulnérable à ces mêmes dynamiques. Je suis attiré par les informations fausses. Nous sommes tous attirés par les informations fausses. Et voici quelques-unes des raisons pour lesquelles. »
J'aborde ce que j'appelle les « trois C » : nos besoins de compréhension, de contrôle et de communauté. Ce sont des besoins fondamentaux qui façonnent non seulement nos comportements au quotidien, mais aussi la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure.
Lorsque nous cherchons à comprendre notre monde, les conséquences ne se limitent pas à la politique. Elles concernent également la santé. Si nous sommes confrontés à des informations qui nous donnent l'impression de comprendre ce qui se passe, de maîtriser une situation ou de nous sentir véritablement connectés à notre communauté, leur véracité empirique importe peu, car elles répondent à des besoins plus fondamentaux qui nous guident. C'est précisément ce qui alimente notre soif de désinformation.
Comment nos identités affectent-elles notre relation à l’information ?
Notre univers médiatique politique encourage et encourage à se considérer comme des membres d'équipes politiques géantes, de gauche comme de droite. Ces identités sont constamment réactivées par notre vision et les réseaux sociaux. Nos besoins de compréhension, de contrôle et de communauté sont alors au service de notre « équipe ».
Nous voulons appréhender le monde comme notre équipe politique. Nous voulons contrôler le monde de manière bénéfique pour notre équipe politique. Et nous voulons créer une communauté à l'image de notre équipe politique.
Notre monde politique et médiatique cultive ces identités de manière à maintenir ce moteur en marche et à maintenir à un niveau élevé notre demande de « mensonges identitaires ».
Les professionnels de santé discutent avec leurs patients. De plus, leurs proches peuvent les contacter pour leur poser des questions sur la santé. Utilisons-nous différentes stratégies pour communiquer avec quelqu'un lorsque nous entretenons déjà une relation personnelle, pour le meilleur ou pour le pire ?
J'ai des amis proches qui sont médecins, et je leur demande toujours un avis médical en premier. J'ai le sentiment que la façon dont mes amis médecins me parlent est celle dont les professionnels de santé devraient parler à tout le monde.
Ils diront des choses comme : « Si c'était mon proche, je lui dirais de suivre ce traitement », ou encore : « D'après mon expérience, je n'ai jamais vu ça arriver auparavant. » Ce n'est pas une question de probabilités statistiques. C'est très humain. Ils parlent avec émotion et compassion, et expriment même une certaine incertitude dans leur approche.
Dans mes travaux récents, j'ai exploré certaines des conséquences de la montée des mouvements populistes à travers le monde. Les dirigeants populistes dénoncent souvent la corruption en politique, dans les médias, dans la science ou la santé, et leur discours promet de donner du pouvoir au « peuple ». Le langage populiste tend à célébrer une compréhension du monde fondée sur le bon sens – une compréhension profane. Celle-ci privilégie le tangible et l'intuitif plutôt que les données, les preuves ou les théories abstraites. Elle repose sur le principe suivant : « Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai vu, voici ce que je ressens, donc voici ce que je crois. » Et cette compréhension profane peut souvent inciter les gens à rejeter la science et les faits sanitaires, au profit de remèdes alternatifs et de la désinformation sanitaire.
Même si cette tendance peut frustrer les acteurs des milieux de la santé et des sciences, il existe des moyens d'aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent : adopter une approche profane pour comprendre le monde et communiquer nos travaux. En réalité, à vrai dire, cela correspond davantage à notre mode de vie quotidien. Non, ce n'est pas ainsi que nous faisons de la science, car il y a une procédure et une méthode, mais nous valorisons tous l'intuition. Nous valorisons tous l'expérience directe. Nous faisons tous appel au « bon sens ».
Nous pouvons réfléchir à des moyens de communiquer les résultats scientifiques qui intègrent l’intuition, l’émotion et notre expérience vécue, tout en restant cohérents avec les résultats empiriques.
Nous savons que l’utilisation de la peur pour tenter de motiver des comportements sains peut se retourner contre nous.
Oui. Il est essentiel d'avoir des informations [sur la menace] pour motiver les gens. Mais elles doivent être associées à des informations sur l'efficacité, c'est-à-dire des mesures concrètes que la personne peut prendre pour éviter la menace, ainsi qu'à des indications indiquant que cela réduira le risque d'être blessé. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens oublient.
Lors de votre entretien avec l'ABIM , vous avez parlé de la nécessité de comprendre les communautés. Vous avez affirmé que même lorsque les gens partagent de fausses informations sur la manière de répondre à leurs besoins, « les besoins eux-mêmes ne sont jamais faux ». Avez-vous des suggestions pour que les professionnels de la santé puissent mieux écouter ces besoins ?
Premièrement, le simple fait de prendre conscience que ces besoins sont en soi raisonnables change parfois la perspective des professionnels de santé à travers laquelle ils perçoivent ces groupes, plutôt que de les considérer comme des personnes ayant une vision erronée. Cela peut créer une dynamique plus saine et favoriser un dialogue plus constructif et productif.
Deuxièmement, cela permet de se demander : « Quel est le besoin qui sous-tend cette perception erronée ? » Par exemple, croire que la COVID n'existe pas ? C'est une perception erronée pleine d'espoir. Elle donne l'impression que tout va bien. Du genre : « J'ai le contrôle, ce n'est pas réel. » Parfois, les menaces sont si grandes et si terrifiantes que nous créons un faux récit pour nous rassurer.
Une fois cela reconnu, l'étape suivante consiste à communiquer sur la menace tout en préservant l'autonomie de la personne. Reconnaître que nous voulons avoir le sentiment d'avoir du pouvoir. Il existe de véritables mécanismes de pouvoir et de contrôle. Par exemple, si l'on repense à la COVID-19, l'un de ces moyens est le port du masque. L'un de ces moyens est la vaccination.
C'est très difficile de parler de personnes qui ont une perception erronée, car elles sont intégrées à une communauté qui partage cette même perception. Tenter de s'attaquer directement à cette perception erronée entraîne parfois des réactions négatives.
Pourquoi ne pas plutôt exploiter une identité sociale commune, extérieure au monde social qui les pousse à croire à ce mensonge – en dehors de la politique, par exemple. Peut-être une identité sociale liée à un lieu physique et à sa communauté ? Par exemple : « Nous sommes tous les deux parents. Nous venons de cette même communauté géographique. » Ou même dire : « Nous soutenons tous les deux la même équipe sportive. »
Comment dialoguer avec les membres des communautés qui ont été et continuent d'être lésés par les établissements de santé ? Comment améliorer la communication ?
Ces approches ne peuvent pas se limiter à la communication. Elles doivent être des approches comportementales de la part de la communauté médicale. Il ne s'agit pas d'une simple campagne de relations publiques.
La confiance se mérite. La communauté médicale doit reconnaître les torts. Il y a des raisons à ce manque de confiance. Nous pouvons dire : « Voici ce que nous faisons au sein de la communauté pour réparer les torts du passé. »
Parfois, la communauté médicale commet des erreurs. On ne peut pas prétendre que tout le monde a de bonnes raisons de lui faire confiance. Il est important de communiquer ouvertement.
Je parle beaucoup d'humilité intellectuelle – l'ouverture à l'erreur – et de vulnérabilité personnelle. Il s'agit de dire et d'accepter : « Voilà où j'en suis, d'après ce que je sais jusqu'à présent, mais je peux me tromper. » Les personnes au pouvoir ne sont pas habituées à la vulnérabilité ou à l'humilité. Si l'objectif est d'instaurer la confiance et de la mériter, alors l'humilité et la vulnérabilité sont nécessaires.
Outre l’humilité et la vulnérabilité, comment pouvons-nous nous protéger davantage contre la désinformation ?
En amont, j'observe les habitudes que nous adoptons et qui tendent à réactiver subtilement les identités politiques, nous poussant ainsi à rechercher des mensonges. Comment pouvons-nous les perturber ?
Cela tient en grande partie à l'évolution de nos interactions en ligne. Il faut être un peu plus honnête sur les points qui nous empêchent de nous intégrer à notre équipe politique. Parfois, face à la forte pression sociale qui nous pousse à être à la hauteur de notre équipe, nous gardons le silence sur certains sujets sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Mais en étant honnêtes, nous donnerons du pouvoir et de la voix à ceux qui ne correspondent pas à la caricature. Cela créera une nouvelle identité commune, d'une manière que nous pourrions croire impossible.
Vous parlez beaucoup du pouvoir de l'identité partagée. Comment pouvons-nous développer des communautés qui ont un impact positif sur les valeurs communes ?
Il est clair que lorsque les gens investissent dans leurs communautés géographiques et activent leur identité en tant que membres de leur quartier et de leur ville, cela atténue beaucoup de ce dont nous avons parlé. Cela atténue un peu les identités politiques, car nous avons des choses qui nous tiennent à cœur en commun.
Je suis toujours optimiste. Certains loisirs et aspects de notre culture rassemblent les gens au quotidien. J'ai également été inspiré par le fait que certaines des émissions les plus populaires de ces cinq dernières années étaient des émissions de tous bords politiques. Les êtres humains aspirent à avoir des points communs, et je suis convaincu que nous les trouverons.
Note de l'éditeur : Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.
Vous pourriez également être intéressé par :
Vous ne pouvez pas participer au IHI Forum, du 8 au 11 décembre 2024 à Orlando ? Inscrivez-vous au livestream pour accéder aux événements sur la scène principale, où que vous soyez.
Comment une meilleure utilisation de la technologie peut libérer du temps pour de meilleurs soins
Berwick sur les besoins actuels des soins de santé
Tembi Locke, écrivaine et militante, sur l'amour, la perte et la création d'espaces de guérison